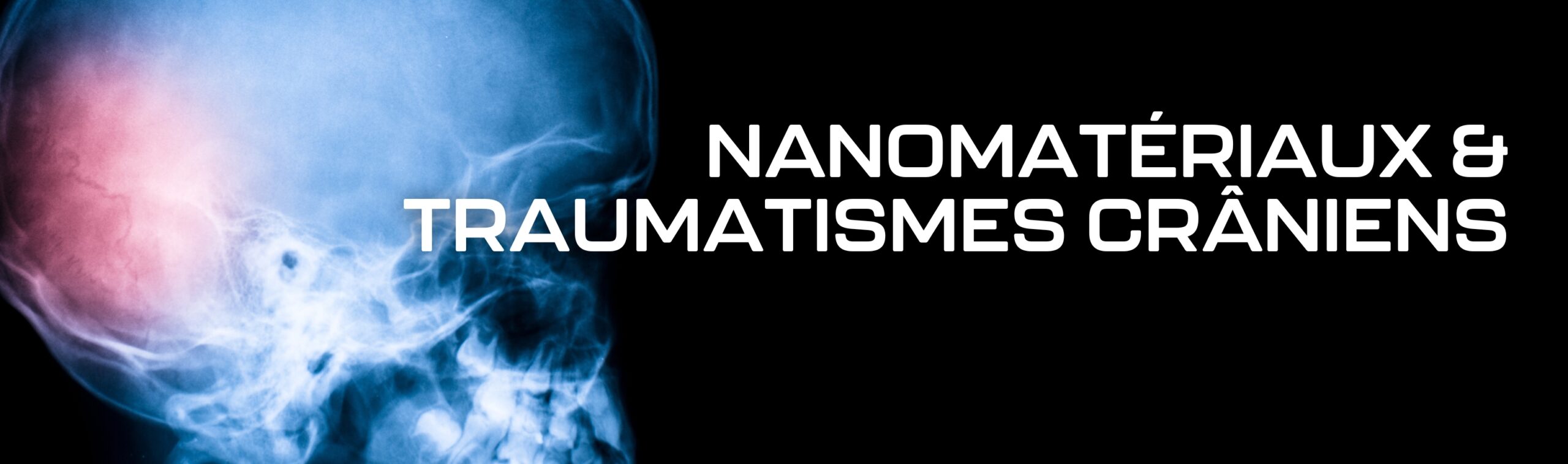
Les traumatismes crâniens (TCC) constituent un défi majeur de santé publique : à l’impact mécanique initial s’ajoutent des phases secondaires — inflammation, stress oxydatif, rupture de la barrière hémato-encéphalique, dégénérescence neuronale — qui complexifient la prise en charge. Dans ce cadre, les nanomatériaux théranostiques apparaissent comme une stratégie novatrice en combinant diagnostic et thérapie.
Le terme « théranostique » renvoie à l’intégration simultanée de fonctions thérapeutiques et diagnostiques (imagerie, capteurs, libération contrôlée de médicament) à l’échelle nanométrique.
Dans l’étude, référencée par le site Pusan National University, dirigée par le professeur Yun Hak Kim (et publiée dans la revue Journal of Nanobiotechnology le 29 octobre 2025), il est précisé que ces nanoplateformes peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, reconnaître les tissus endommagés et délivrer des agents neuroprotecteurs tout en assurant un suivi en temps réel.
Innovations technologiques et nanomatériaux théranostiques
Les nanomatériaux théranostiques combinent plusieurs éléments pour être performants :
-
des nanoparticules capables de transporter des molécules (neuroprotecteurs, anti-inflammatoires, ARN siRNA) jusqu’aux zones lésées,
-
des capteurs ou composants « intelligents » réagissant à des stimuli biologiques (acidité locale, espèces réactives de l’oxygène (ROS), activité enzymatique) pour déclencher la libération de médicament ou émettre un signal diagnostique,
-
l’intégration diagnostique (imagerie, fluorescence, capteurs biomarqueurs) + thérapeutique (libération ciblée, modulation de l’inflammation, protection neuronale).
Les nanomatériaux théranostiques utilisés dans cette étude
L’étude évoque explicitement plusieurs types de nanoparticules :
-
nanoparticules de polystyrène PEGylée ;
-
nanoparticules de silicium poreux,
-
nanoparticules à base de points de carbone (carbon dots) agissant comme nano-enzymes (nanozymes) pour neutraliser les molécules réactives de l’oxygène,
-
nanoparticules de type dendrimères,
-
nanoparticules lipidiques (LNP *= « lipid nanoparticle ») capables de cibler les tissus endommagés et de libérer des molécules neuroprotectrices,
-
nanosenseurs à base de peptides ciblés sur la matrice extracellulaire (MEC), polymères, fibrinogène, sensibles aux biomarqueurs de lésion cérébrale.
Les défis et enjeux des nanomatériaux théranostiques
La revue insiste également sur les défis suivants :
-
la biocompatibilité et la dégradation sécurisée des nanomatériaux afin d’éviter l’accumulation chronique dans le cerveau ou d’autres tissus.
-
la traduction clinique : si les résultats précliniques sont prometteurs, il reste à démontrer la sécurité, la reproductibilité, la maniabilité à grande échelle.
-
l’intégration des nanomatériaux avec des outils d’intelligence artificielle et de bio-ingénierie pour permettre un traitement adaptatif et personnalisé, comme mentionné dans l’article du site Ma Clinique.
En tant qu’acteur du domaine des nanomatériaux avancés, et partenaire du projet i-NanoT*, SON s’intéresse évidemment de près aux études portant sur les nanomatériaux théranostiques.
Quelles implications cliniques pour les patients de ces nanomatériaux théranostiques ?
L’intégration des diagnostics et traitements dans une seule plateforme permet plusieurs bénéfices :
-
détection plus rapide et plus fine des lésions cérébrales (y compris celles difficilement visibles au scanner ou IRM classique) via des capteurs nanométriques,
-
délivrance ciblée de traitements (réduction des effets secondaires, meilleure concentration locale),
surveillance en temps réel de la réponse au traitement, possibilité d’ajustement adaptatif. Cela ouvre la voie à une médecine cérébrale plus personnalisée, moins invasive et potentiellement plus efficace.
Une fois de plus, l’utilisation de nanomatériaux avancés en médecine semble prometteuse. Sky is the limit, dirait-on en anglais. Impossible n’est pas Français, encore moins SON, dirait-on ici !
Le projet i-NanoT est soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté et par la Commission européenne dans le cadre du programme FEDER-FSE+ Bourgogne Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027.

